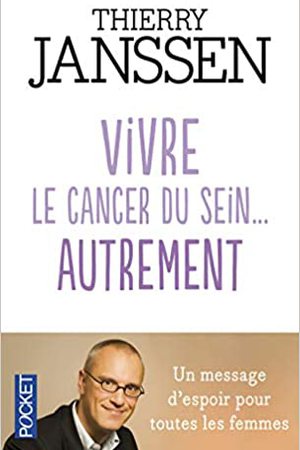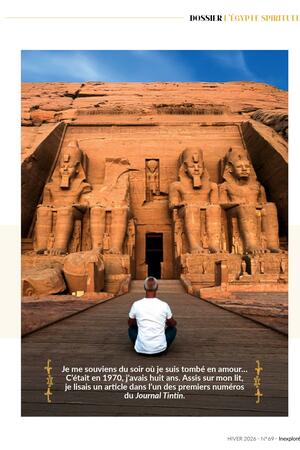Le cancer, au-delà des croyances
Conférence prononcée aux Entretiens de Millancay, le 3 octobre 2008.
On ne peut pas s’intéresser au cancer sans en aborder les différents aspects psychiques, psychologiques et sociaux. Ceux-ci sont au coeur de ma pratique d’accompagnement des malades. Or, au cours de cette pratique, j’ai été interpellé par le fait que de nombreux patients ont spontanément tendance à rattacher leurs problèmes de santé à un évènement ou à des circonstances de vie qui ont été difficiles à vivre d’un point de vue émotionnel.
Une étude scandinave révèle que 40 % des femmes interrogées, atteintes d’un cancer du sein, sont convaincues que leur maladie est la conséquence d’un traumatisme psychologique, une situation émotionnellement mal vécue qui se serait produite dans les mois qui ont précédés le diagnostic du cancer. Or, lorsque l’on effectue des études rétrospectives, un lien de causalité entre un traumatisme psychologique et le déclenchement d’un cancer est loin d’être prouvé. Sans doute parce que, si lien il y a, celui-ci participe d’un ensemble de causes dont la synergie favorise le déclenchement de la maladie. Comme la plupart des pathologies, le cancer est une maladie multifactorielle. Il faudrait donc des études prospectives pour parvenir à démonter l’implication de causes psychologiques ou l’influence des « conflits » émotionnels dans la genèse des cancers. De telles études sont très compliquées à réalisées, d’autant plus que pour être interprétables sans équivoque, il faudrait qu’elles incluent un très grand nombre de personnes.
Quoi qu’il en soit, il est intéressant d’essayer de comprendre pourquoi de plus en plus de gens sont convaincus de l’existence d’un lien entre leur cancer et des évènements psychologiquement mal vécus. Un nombre non négligeable de ces patients déclarent être persuadés qu’ils ne pourront guérir que s’ils parviennent à identifier et à solutionner le problème psychologique incriminé. Et, quelques-uns, souvent influencés par des thérapeutes adeptes de ce genre de psychologisme, vont même jusqu’à refuser ou à abandonner les traitements conventionnels – chimiothérapie, chirurgie ou radiothérapie – au profit d’un travail psychothérapeutique censé déclencher la guérison.
L’une des raisons à l’origine de cette situation réside probablement dans le fait que la médecine telle que nous l’avons développée en Occident est une médecine toute-puissante qui utilise des moyens de plus en plus sophistiqués et agressifs pour « faire la guerre » à la maladie. Dans le cas du cancer, ces moyens thérapeutiques sont de véritables « bombes » dont les effets ne sont pas aussi ciblés que l’on pourrait l’espérer (même si de nouveaux traitements plus précis sont en train d’émerger). Du coup, les patients ont peur. Ils sont d’autant plus effrayés que la médecine technologique ne s’intéresse à eux qu’en tant qu’objets, oubliant de les écouter, de leur parler, de les rassurer. Pourtant, les malades sont avant tout des sujets – des êtres qui pensent, qui ont des croyances, qui éprouvent des sentiments et ressentent des émotions. Je rencontre régulièrement des malades atteints par un cancer qui, en s’intéressant aux prétendues causes psychologiques de leur maladie, espèrent pouvoir reprendre un certain contrôle sur le corps, sur leur guérison et sur leur vie.
Malheureusement, j’en ai rencontrés aussi plusieurs qui, le cancer continuant à se propager, finissent par se culpabiliser, convaincus de ne pas avoir été suffisamment en profondeur dans leur travail psychothérapeutique pour obtenir la guérison. Cela paraît totalement absurde et pourtant, j’ai accompagné des personnes jusqu’aux portes de leur mort sans pouvoir leur ôter de l’esprit qu’elles auraient pu inverser le cours de leur pathologie si elles étaient parvenues à transformer leur vie d’une manière plus catégorique.
Il paraît donc important de remettre les pendules à l’heure. Sans nier la participation d’éventuels facteurs psychologiques dans la genèse du cancer – participation encore non vraiment démontrée –, il faut insister sur le fait que cette pathologie est d’origine multifactorielle. Si des facteurs psychologiques interviennent dans son déclenchement ce n’est probablement pas d’une manière aussi prépondérante que certains l’affirment. A ce jour, il semble raisonnable d’envisager le stress chronique parmi les multiples facteurs qui peuvent fragiliser l’individu et le rendre plus sensible à d’autres influences cancérigènes.
Ainsi, par exemple, une étude publiée en 2004 dans Proceedings the National Academy of Sciences a comparé les chromosomes de femmes qui vivaient le stress de manière chronique et les chromosomes de femmes qui parvenaient à gérer les évènements stressants de leur existence, échappant ainsi au stress chronique. Les résultats de cette comparaison sont absolument interpellants. En effet, il est apparu que les femmes stressées de manière chronique ont des chromosomes usés, abîmés comme si elles avaient, en moyenne, dix ans de plus.
En particulier les télomères de ces chromosomes (sortes de petits capuchons situés à l’extrémité des chromosomes, servant à réparer les chromosomes lorsque ceux-ci sont le siège de mutations génomiques), sont apparus raccourcis prématurément chez les femmes stressées de manière chronique. Le stress chronique apparaît donc comme un facteur de vieillissement au niveau du patrimoine génétique. Or, on sait depuis longtemps que le cancer est la conséquence d’un dérèglement en lien avec des mutations génétiques. On peut donc imaginer que des personnes stressées durant de longues périodes finissent par avoir des chromosomes plus sensibles à différentes influences – alimentaires, toxiques ou infectieuses – qui induisent alors des mutations géniques. Celles-ci ne pouvant plus être réparées de manière efficace par les télomères, déclencheraient le phénomène de cancérisation.
De la même manière il n’est pas stupide d’imaginer que dans ce contexte multifactoriel, qu’un stress aigu (isolé ou ajouté au stress chronique), causé par un évènement mal vécu émotionnellement, puisse affaiblir les défenses immunitaires d’une personne et accélérer ainsi un processus de cancérisation latent, favorisant alors le développement rapide des cellules malignes et, au-delà d’un certain seuil, l’apparition d’une tumeur détectable.
Ceci expliquerait pourquoi et comment un certain nombre de cancers sont diagnostiqués chez des personnes peu de temps après un choc psychologique ou un deuil. Ainsi, sans sombrer dans le psychologisme, on ne peut pas éluder la question des éventuelles causes psychologiques des cancers. Personnellement, je pense que les médecins réfractaires à cette idée font erreur.
Le grand danger du psychologisme ambiant est de minimiser les causes non psychologiques du cancer – causes qui sont nombreuses et de toute évidence absolument prépondérantes. Si nous voulons « gagner » notre bataille contre cette maladie, il nous faut prendre de la hauteur, il nous faut absolument en envisager toutes les causes – psychologiques et non psychologiques – et, surtout, toutes les causes non visibles, au premier rang desquelles se situent les causes environnementales et alimentaires. Cet exercice est loin d’être évident pour nos esprits occidentaux. En effet, depuis trois cents ans – depuis ce que nous appelons « le siècle des Lumières » - , nous vivons dans un paradigme réductionniste. Face à la complexité, nous tentons d’isoler des faits qui nous permettent d’établir des relations de cause à effet simples. Or la simplicité est séduisante mais elle est rarement le reflet de la réalité. Car, la réalité est souvent éminemment complexe. La simplicité, elle, nous permet de croire que nous pouvons contrôler la réalité. Elle nous maintient dans l’illusion d’une toutepuissance très peu réaliste.
Le fait est que nos esprits modernes et occidentaux sont prisonniers d’un postulat philosophique qui affirme que l’être humain est « en dehors de la nature, que la nature est dangereuse et que l’être humain doit utiliser son intelligence pour la comprendre dans ses moindres détails afin de la contrôler, de l’influencer, de la dominer. Songeons que John Locke – philosophe contemporain de René Descartes – écrivit que « la voie du bonheur passe par la négation de la nature ». Remarquons qu’à force d’oublier que nous sommes parties intégrantes de la nature, nous cherchons notre bonheur en nous niant nous-mêmes ! La pensée des Lumières a donné naissance à une science analytique dont l’efficacité est réelle. Cependant en privilégiant une vision détaillée et morcelée de la nature, cette pensée nous a fait perdre la conscience des liens qui s’existent entre les différents éléments de notre analyse – liens qui sont pourtant l’essence même de la vie.
Il ne faut pas sous-estimer l’influence de nos représentations morcelées de la réalité sur nos manières de penser et de nous comporter. Lorsque j’attire l’attention des étudiants en deuxième année des études de médecine sur ce fait, je constate beaucoup de curiosité et d’ouverture d’esprit de leur part. Ils sont capables de relativiser leurs certitudes et d’essayer d’élargir leur conscience. Malheureusement, lorsque je retrouve les mêmes étudiants, trois ans plus tard, la plupart d’entre eux ont perdu cette capacité d’ouverture. Véritablement endoctrinés par une vision réductrice de la réalité, ils sont complètement conditionnés à découper l’être humain en petits morceaux, isoler des organes et des pathologies, identifier des causes, et tester des remèdes de manière indépendante, séparée, sans tenir compte de la globalité et de la complexité.
C’est affligeant.
Néanmoins, il ne serait pas juste de diaboliser ces étudiants, futurs médecins. Nous vivons dans une société où la diabolisation est trop souvent présente. Il ne s’agit pas d’opposer des « bons » et des « méchants », des esprits ouverts ou fermés, des soignants trop réducteurs et d’autres qui auraient compris l’essence du vivant. Il s’agit de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé à penser l’être humain et le monde d’une certaine façon plutôt qu’une autre. Il s’agit donc de s’intéresser à nos représentations de la réalité et, si nous constatons que celles-ci sont imprécises, inexactes ou trop réduites, à nous de les faire évoluer. A nous aussi d’inviter nos contemporains à revoir, eux-aussi, leurs représentations de la réalité. Car il n’y a que par la pédagogie que l’on peut espérer faire évoluer les idées et, de là, les actions qui façonnent le monde. Cette pédagogie est sans doute la chose la plus difficile à mettre en place. Car rien n’est plus fastidieux à faire évoluer que les représentations et les systèmes de croyances sur lesquels se sont construites les sociétés.
Il y a quelques années, je séjournais dans une communauté aborigène, dans le nord de l’Australie. Il y avait là un instituteur qui affirmait que les Occidentaux avaient une vision « plate » du monde. Je n’étais pas d’accord avec lui, argumentant que les Occidentaux avaient réussi à photographier à notre planète depuis l’espace et que nous avions apporté la preuve irréfutable de la rotondité de la Terre. L’homme m’emmena dans sa classe, un baraquement fait de tôles ondulées au fond duquel était suspendu un planisphère. D’un oeil amusé, il me fit remarquer que lorsque les Occidentaux veulent éliminer un déchet, ils ont l’habitude de le jeter le plus loin possible, de sorte qu’une fois disparu de leur regard, ils imaginent être définitivement débarrassés du problème. « Cela prouve que les Occidentaux croient encore que la Terre est plate, me dit l’instituteur. Car, si ils avaient réellement intégré le fait qu’en réalité la Terre est ronde, ils se rappelleraient qu’au plus loin ils jettent leurs déchets, au plus ceuxci risquent de leur revenir dans le dos ! » Sagesse aborigène. Humilité bien nécessaire de reconnaître les effets pervers de nos représentations erronées de la réalité. Humilité qui tire sa racine latine dans « humus » - la terre, cette terre à laquelle nous appartenons. Cet « humus » qui est aussi la racine latine de « humanité ». L’occasion de nous rappeler que nous ne sommes vraiment et pleinement humains que lorsque nous sommes vraiment humbles.
C’est de cette humilité dont auront besoin les chercheurs engagés dans la « bataille du cancer » car, comment pourrait-on imaginer comprendre l’étendue de cette maladie sans en appréhender toute la complexité ? Trop souvent encore, certains spécialistes nous rassurent sur l’innocuité de certains facteurs potentiellement cancérigènes en oubliant que les études sur lesquelles ils se basent ne tiennent absolument pas compte de la complexité. Isoler une cause potentielle et en démontrer l’absence de dangerosité ne reflète pas toujours ce qui peut se produire dans la réalité. En effet, les causes sont rarement isolées et il faudrait tenir compte d’une éventuelle synergie entre différents facteurs potentiellement pathogènes pour en apprécier toute les conséquences. Humilité !
J’ai connu un étudiant en médecine camerounais, inscrit en faculté de médecine à Paris, fils d’un guérisseur traditionnel dans son pays. « Depuis que j’étudie la cancérologie, je me rends compte que les êtres humains se comportent comme des cellules malignes, me dit-il un jour. Animées d’une vitalité prodigieuse, ces cellules se multiplient en très grand nombre, détruisent le lieu de leur naissance, consomment toutes les ressources disponibles et se propagent à travers l’organisme. Guidées par une intelligence redoutable, elles s’infiltrent partout, résistent aux traitements utilisés pour les combattre, ne connaissent aucune limite à leur extension, et finissent par tuer le corps de la personne qui les nourries. Il suffit de contempler le désastre écologique pour comprendre que l’humanité est le cancer de la Terre. Nous devrions nous méfier car, privées de leur support, les cellules malignes meurent à leur tour. » Sagesse africaine. Appel à la responsabilité, aussi. Car, même face à une maladie aussi préoccupante et effrayante que le cancer nous sommes habilités à apporter des réponses.
Respons-abilité. Ainsi, par exemple, il y a en France des acteurs du monde de la santé qui font preuve d’humilité et de responsabilité. Regroupés au sein du Comité pour le développement durable en santé (C2DS), ces professionnels, tous plus ou moins impliqués dans les infrastructures et les métiers destinés à prendre en charge les malades, tentent de réfléchir aux mesures à mettre en place pour éviter de créer de la maladie tout en continuant à soigner les malades. Crée à l’initiative d’Olivier Toma, ancien directeur de la clinique Champeau à Bézier, ce comité a pris conscience que l’hôpital constitue une petite société qui, à l’instar de notre société, pollue et favorise l’émergence de pathologies. Dénonçant cette incohérence, les professionnels – directeurs d’hôpitaux, soignants, administratifs, architectes, responsables de centrales d’achats, responsables de l’approvisionnement et de nombreux autres –, réunis dans ce comité, cherchent les moyens de réduire les gaspillages de ressources et d’énergies, les pollutions environnementales, les stress toxiques pour les malades et pour les travailleurs hospitaliers… La démarche constitue une belle tentative d’un retour à la cohérence entre l’intention de promouvoir la santé et les actes nécessaires pour y parvenir. Elle me paraît absolument fondamentale pour l’avenir. Elle est essentielle en ce sens qu’elle redonne du sens à la médecine.
Dans mon livre La maladie a-t elle un sens ? , je constate que la question du sens est aujourd’hui évacuée du débat médical ; de la même manière qu’elle est évacuée des préoccupations de notre civilisation. Innover, produire et consommer semble suffire à calmer les angoisses existentielles de nos contemporains et apparaît comme un gage suffisant pour la survie de l’humanité. Pourtant, toute fuite en avant peut devenir dangereuse si on ne se pose la question du sens. Car c’est le sens qui définit la direction de notre progression. Comme toutes les crises de l’existence, la maladie est une invitation à s’interroger sur ce sens. Il semble donc important d’en comprendre les multiples dimensions, les différents enjeux. En effet, la maladie est à la fois une pathologie objectivable par la science (disease, comme disent les anglo-saxons), un malaise vécu subjectivement par les patients (illness), et un évènement social qui interpelle toute la communauté (sickness). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a bien compris lorsque, en 1948, dans son texte fondateur, par opposition à la maladie, elle a définit la santé comme « un état de complet bienêtre à la fois physique, mental et social ». Face à cette complexité, la science médicale tente d’attribuer un « sens biologique » aux pathologies-diseases afin de mieux les diagnostiquer, les soigner et les résoudre. En revanche, elle n’est pas du tout encline à aider les patients dans la recherche du « sens symbolique » qu’ils ont besoin de rattacher à leurs malaises-illnesses. Du coup, la pratique médicale laisse peu de place à l’écoute des malades, elle oublie à quel point il est important pour eux de pouvoir inscrire leur expérience de la souffrance dans le cours de leur existence singulière, en fonction d’un passé auquel ils sont identifiés et, surtout, dans l’espoir d’un futur qu’ils espèrent pouvoir vivre avec ou sans leur pathologie. C’est regrettable car ce « sens symbolique » génère un espoir absolument favorable pour le processus de guérison. De la même manière, la science médicale est peu préparée à considérer le « sens collectif » des maladies-sicknesses. Pourtant, dans de nombreuses cultures traditionnelles, ce « sens collectif » tient une place primordiale dans les rituels thérapeutiques ; à l’occasion de la maladie d’un seul, c’est toute la communauté qui doit s’interroger, chacun de ses membres est invité à revoir ses rapports interpersonnels avec les autres et le groupe dans son ensemble est amené à examiner les relations qu’il entretient avec l’environnement dans lequel il évolue. Cette attitude débouche inévitablement sur des mesures préventives qui manquent cruellement dans notre rapport moderne à la maladie. A fortiori lorsque cette maladie prend le nom de « cancer » !
Pour terminer cette réflexion à propos du cancer, j’aimerais citer Viktor Frankl, psychiatre viennois qui au retour des camps de concentration de la seconde Guerre mondiale a écrit le très bel ouvrage Découvrir un sens à sa vie. « L’important n’était pas ce que nous attendions de la vie, mais ce que la nous apportions à la vie, écrit-il. Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait s’imaginer que c’était à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. » Pourvu qu’au-delà de nos croyances, au-delà de nos représentations imparfaites de la réalité, nous ayons la sagesse d’élargir notre champ de vision, de changer notre regard sur le monde et sur nous-mêmes afin que, confrontés à l’augmentation du nombre des cancers, nous comprenions qu’il y a là une opportunité unique de grandir et d’évoluer.
Article concernant le livre
Conférence prononcée aux Entretiens de Millancay, le 3 octobre 2008.
On ne peut pas s’intéresser au cancer sans en aborder les différents aspects psychiques, psychologiques et sociaux. Ceux-ci sont au coeur de ma pratique d’accompagnement des malades. Or, au cours de cette pratique, j’ai été interpellé par le fait que de nombreux patients ont spontanément tendance à rattacher leurs problèmes de santé à un évènement ou à des circonstances de vie qui ont été difficiles à vivre d’un point de vue émotionnel.
Une étude scandinave révèle que 40 % des femmes interrogées, atteintes d’un cancer du sein, sont convaincues que leur maladie est la conséquence d’un traumatisme psychologique, une situation émotionnellement mal vécue qui se serait produite dans les mois qui ont précédés le diagnostic du cancer. Or, lorsque l’on effectue des études rétrospectives, un lien de causalité entre un traumatisme psychologique et le déclenchement d’un cancer est loin d’être prouvé. Sans doute parce que, si lien il y a, celui-ci participe d’un ensemble de causes dont la synergie favorise le déclenchement de la maladie. Comme la plupart des pathologies, le cancer est une maladie multifactorielle. Il faudrait donc des études prospectives pour parvenir à démonter l’implication de causes psychologiques ou l’influence des « conflits » émotionnels dans la genèse des cancers. De telles études sont très compliquées à réalisées, d’autant plus que pour être interprétables sans équivoque, il faudrait qu’elles incluent un très grand nombre de personnes.
Quoi qu’il en soit, il est intéressant d’essayer de comprendre pourquoi de plus en plus de gens sont convaincus de l’existence d’un lien entre leur cancer et des évènements psychologiquement mal vécus. Un nombre non négligeable de ces patients déclarent être persuadés qu’ils ne pourront guérir que s’ils parviennent à identifier et à solutionner le problème psychologique incriminé. Et, quelques-uns, souvent influencés par des thérapeutes adeptes de ce genre de psychologisme, vont même jusqu’à refuser ou à abandonner les traitements conventionnels – chimiothérapie, chirurgie ou radiothérapie – au profit d’un travail psychothérapeutique censé déclencher la guérison.
L’une des raisons à l’origine de cette situation réside probablement dans le fait que la médecine telle que nous l’avons développée en Occident est une médecine toute-puissante qui utilise des moyens de plus en plus sophistiqués et agressifs pour « faire la guerre » à la maladie. Dans le cas du cancer, ces moyens thérapeutiques sont de véritables « bombes » dont les effets ne sont pas aussi ciblés que l’on pourrait l’espérer (même si de nouveaux traitements plus précis sont en train d’émerger). Du coup, les patients ont peur. Ils sont d’autant plus effrayés que la médecine technologique ne s’intéresse à eux qu’en tant qu’objets, oubliant de les écouter, de leur parler, de les rassurer. Pourtant, les malades sont avant tout des sujets – des êtres qui pensent, qui ont des croyances, qui éprouvent des sentiments et ressentent des émotions. Je rencontre régulièrement des malades atteints par un cancer qui, en s’intéressant aux prétendues causes psychologiques de leur maladie, espèrent pouvoir reprendre un certain contrôle sur le corps, sur leur guérison et sur leur vie.
Malheureusement, j’en ai rencontrés aussi plusieurs qui, le cancer continuant à se propager, finissent par se culpabiliser, convaincus de ne pas avoir été suffisamment en profondeur dans leur travail psychothérapeutique pour obtenir la guérison. Cela paraît totalement absurde et pourtant, j’ai accompagné des personnes jusqu’aux portes de leur mort sans pouvoir leur ôter de l’esprit qu’elles auraient pu inverser le cours de leur pathologie si elles étaient parvenues à transformer leur vie d’une manière plus catégorique.
Il paraît donc important de remettre les pendules à l’heure. Sans nier la participation d’éventuels facteurs psychologiques dans la genèse du cancer – participation encore non vraiment démontrée –, il faut insister sur le fait que cette pathologie est d’origine multifactorielle. Si des facteurs psychologiques interviennent dans son déclenchement ce n’est probablement pas d’une manière aussi prépondérante que certains l’affirment. A ce jour, il semble raisonnable d’envisager le stress chronique parmi les multiples facteurs qui peuvent fragiliser l’individu et le rendre plus sensible à d’autres influences cancérigènes.
Ainsi, par exemple, une étude publiée en 2004 dans Proceedings the National Academy of Sciences a comparé les chromosomes de femmes qui vivaient le stress de manière chronique et les chromosomes de femmes qui parvenaient à gérer les évènements stressants de leur existence, échappant ainsi au stress chronique. Les résultats de cette comparaison sont absolument interpellants. En effet, il est apparu que les femmes stressées de manière chronique ont des chromosomes usés, abîmés comme si elles avaient, en moyenne, dix ans de plus.
En particulier les télomères de ces chromosomes (sortes de petits capuchons situés à l’extrémité des chromosomes, servant à réparer les chromosomes lorsque ceux-ci sont le siège de mutations génomiques), sont apparus raccourcis prématurément chez les femmes stressées de manière chronique. Le stress chronique apparaît donc comme un facteur de vieillissement au niveau du patrimoine génétique. Or, on sait depuis longtemps que le cancer est la conséquence d’un dérèglement en lien avec des mutations génétiques. On peut donc imaginer que des personnes stressées durant de longues périodes finissent par avoir des chromosomes plus sensibles à différentes influences – alimentaires, toxiques ou infectieuses – qui induisent alors des mutations géniques. Celles-ci ne pouvant plus être réparées de manière efficace par les télomères, déclencheraient le phénomène de cancérisation.
De la même manière il n’est pas stupide d’imaginer que dans ce contexte multifactoriel, qu’un stress aigu (isolé ou ajouté au stress chronique), causé par un évènement mal vécu émotionnellement, puisse affaiblir les défenses immunitaires d’une personne et accélérer ainsi un processus de cancérisation latent, favorisant alors le développement rapide des cellules malignes et, au-delà d’un certain seuil, l’apparition d’une tumeur détectable.
Ceci expliquerait pourquoi et comment un certain nombre de cancers sont diagnostiqués chez des personnes peu de temps après un choc psychologique ou un deuil. Ainsi, sans sombrer dans le psychologisme, on ne peut pas éluder la question des éventuelles causes psychologiques des cancers. Personnellement, je pense que les médecins réfractaires à cette idée font erreur.
Le grand danger du psychologisme ambiant est de minimiser les causes non psychologiques du cancer – causes qui sont nombreuses et de toute évidence absolument prépondérantes. Si nous voulons « gagner » notre bataille contre cette maladie, il nous faut prendre de la hauteur, il nous faut absolument en envisager toutes les causes – psychologiques et non psychologiques – et, surtout, toutes les causes non visibles, au premier rang desquelles se situent les causes environnementales et alimentaires. Cet exercice est loin d’être évident pour nos esprits occidentaux. En effet, depuis trois cents ans – depuis ce que nous appelons « le siècle des Lumières » - , nous vivons dans un paradigme réductionniste. Face à la complexité, nous tentons d’isoler des faits qui nous permettent d’établir des relations de cause à effet simples. Or la simplicité est séduisante mais elle est rarement le reflet de la réalité. Car, la réalité est souvent éminemment complexe. La simplicité, elle, nous permet de croire que nous pouvons contrôler la réalité. Elle nous maintient dans l’illusion d’une toutepuissance très peu réaliste.
Le fait est que nos esprits modernes et occidentaux sont prisonniers d’un postulat philosophique qui affirme que l’être humain est « en dehors de la nature, que la nature est dangereuse et que l’être humain doit utiliser son intelligence pour la comprendre dans ses moindres détails afin de la contrôler, de l’influencer, de la dominer. Songeons que John Locke – philosophe contemporain de René Descartes – écrivit que « la voie du bonheur passe par la négation de la nature ». Remarquons qu’à force d’oublier que nous sommes parties intégrantes de la nature, nous cherchons notre bonheur en nous niant nous-mêmes ! La pensée des Lumières a donné naissance à une science analytique dont l’efficacité est réelle. Cependant en privilégiant une vision détaillée et morcelée de la nature, cette pensée nous a fait perdre la conscience des liens qui s’existent entre les différents éléments de notre analyse – liens qui sont pourtant l’essence même de la vie.
Il ne faut pas sous-estimer l’influence de nos représentations morcelées de la réalité sur nos manières de penser et de nous comporter. Lorsque j’attire l’attention des étudiants en deuxième année des études de médecine sur ce fait, je constate beaucoup de curiosité et d’ouverture d’esprit de leur part. Ils sont capables de relativiser leurs certitudes et d’essayer d’élargir leur conscience. Malheureusement, lorsque je retrouve les mêmes étudiants, trois ans plus tard, la plupart d’entre eux ont perdu cette capacité d’ouverture. Véritablement endoctrinés par une vision réductrice de la réalité, ils sont complètement conditionnés à découper l’être humain en petits morceaux, isoler des organes et des pathologies, identifier des causes, et tester des remèdes de manière indépendante, séparée, sans tenir compte de la globalité et de la complexité.
C’est affligeant.
Néanmoins, il ne serait pas juste de diaboliser ces étudiants, futurs médecins. Nous vivons dans une société où la diabolisation est trop souvent présente. Il ne s’agit pas d’opposer des « bons » et des « méchants », des esprits ouverts ou fermés, des soignants trop réducteurs et d’autres qui auraient compris l’essence du vivant. Il s’agit de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé à penser l’être humain et le monde d’une certaine façon plutôt qu’une autre. Il s’agit donc de s’intéresser à nos représentations de la réalité et, si nous constatons que celles-ci sont imprécises, inexactes ou trop réduites, à nous de les faire évoluer. A nous aussi d’inviter nos contemporains à revoir, eux-aussi, leurs représentations de la réalité. Car il n’y a que par la pédagogie que l’on peut espérer faire évoluer les idées et, de là, les actions qui façonnent le monde. Cette pédagogie est sans doute la chose la plus difficile à mettre en place. Car rien n’est plus fastidieux à faire évoluer que les représentations et les systèmes de croyances sur lesquels se sont construites les sociétés.
Il y a quelques années, je séjournais dans une communauté aborigène, dans le nord de l’Australie. Il y avait là un instituteur qui affirmait que les Occidentaux avaient une vision « plate » du monde. Je n’étais pas d’accord avec lui, argumentant que les Occidentaux avaient réussi à photographier à notre planète depuis l’espace et que nous avions apporté la preuve irréfutable de la rotondité de la Terre. L’homme m’emmena dans sa classe, un baraquement fait de tôles ondulées au fond duquel était suspendu un planisphère. D’un oeil amusé, il me fit remarquer que lorsque les Occidentaux veulent éliminer un déchet, ils ont l’habitude de le jeter le plus loin possible, de sorte qu’une fois disparu de leur regard, ils imaginent être définitivement débarrassés du problème. « Cela prouve que les Occidentaux croient encore que la Terre est plate, me dit l’instituteur. Car, si ils avaient réellement intégré le fait qu’en réalité la Terre est ronde, ils se rappelleraient qu’au plus loin ils jettent leurs déchets, au plus ceuxci risquent de leur revenir dans le dos ! » Sagesse aborigène. Humilité bien nécessaire de reconnaître les effets pervers de nos représentations erronées de la réalité. Humilité qui tire sa racine latine dans « humus » - la terre, cette terre à laquelle nous appartenons. Cet « humus » qui est aussi la racine latine de « humanité ». L’occasion de nous rappeler que nous ne sommes vraiment et pleinement humains que lorsque nous sommes vraiment humbles.
C’est de cette humilité dont auront besoin les chercheurs engagés dans la « bataille du cancer » car, comment pourrait-on imaginer comprendre l’étendue de cette maladie sans en appréhender toute la complexité ? Trop souvent encore, certains spécialistes nous rassurent sur l’innocuité de certains facteurs potentiellement cancérigènes en oubliant que les études sur lesquelles ils se basent ne tiennent absolument pas compte de la complexité. Isoler une cause potentielle et en démontrer l’absence de dangerosité ne reflète pas toujours ce qui peut se produire dans la réalité. En effet, les causes sont rarement isolées et il faudrait tenir compte d’une éventuelle synergie entre différents facteurs potentiellement pathogènes pour en apprécier toute les conséquences. Humilité !
J’ai connu un étudiant en médecine camerounais, inscrit en faculté de médecine à Paris, fils d’un guérisseur traditionnel dans son pays. « Depuis que j’étudie la cancérologie, je me rends compte que les êtres humains se comportent comme des cellules malignes, me dit-il un jour. Animées d’une vitalité prodigieuse, ces cellules se multiplient en très grand nombre, détruisent le lieu de leur naissance, consomment toutes les ressources disponibles et se propagent à travers l’organisme. Guidées par une intelligence redoutable, elles s’infiltrent partout, résistent aux traitements utilisés pour les combattre, ne connaissent aucune limite à leur extension, et finissent par tuer le corps de la personne qui les nourries. Il suffit de contempler le désastre écologique pour comprendre que l’humanité est le cancer de la Terre. Nous devrions nous méfier car, privées de leur support, les cellules malignes meurent à leur tour. » Sagesse africaine. Appel à la responsabilité, aussi. Car, même face à une maladie aussi préoccupante et effrayante que le cancer nous sommes habilités à apporter des réponses.
Respons-abilité. Ainsi, par exemple, il y a en France des acteurs du monde de la santé qui font preuve d’humilité et de responsabilité. Regroupés au sein du Comité pour le développement durable en santé (C2DS), ces professionnels, tous plus ou moins impliqués dans les infrastructures et les métiers destinés à prendre en charge les malades, tentent de réfléchir aux mesures à mettre en place pour éviter de créer de la maladie tout en continuant à soigner les malades. Crée à l’initiative d’Olivier Toma, ancien directeur de la clinique Champeau à Bézier, ce comité a pris conscience que l’hôpital constitue une petite société qui, à l’instar de notre société, pollue et favorise l’émergence de pathologies. Dénonçant cette incohérence, les professionnels – directeurs d’hôpitaux, soignants, administratifs, architectes, responsables de centrales d’achats, responsables de l’approvisionnement et de nombreux autres –, réunis dans ce comité, cherchent les moyens de réduire les gaspillages de ressources et d’énergies, les pollutions environnementales, les stress toxiques pour les malades et pour les travailleurs hospitaliers… La démarche constitue une belle tentative d’un retour à la cohérence entre l’intention de promouvoir la santé et les actes nécessaires pour y parvenir. Elle me paraît absolument fondamentale pour l’avenir. Elle est essentielle en ce sens qu’elle redonne du sens à la médecine.
Dans mon livre La maladie a-t elle un sens ? , je constate que la question du sens est aujourd’hui évacuée du débat médical ; de la même manière qu’elle est évacuée des préoccupations de notre civilisation. Innover, produire et consommer semble suffire à calmer les angoisses existentielles de nos contemporains et apparaît comme un gage suffisant pour la survie de l’humanité. Pourtant, toute fuite en avant peut devenir dangereuse si on ne se pose la question du sens. Car c’est le sens qui définit la direction de notre progression. Comme toutes les crises de l’existence, la maladie est une invitation à s’interroger sur ce sens. Il semble donc important d’en comprendre les multiples dimensions, les différents enjeux. En effet, la maladie est à la fois une pathologie objectivable par la science (disease, comme disent les anglo-saxons), un malaise vécu subjectivement par les patients (illness), et un évènement social qui interpelle toute la communauté (sickness). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a bien compris lorsque, en 1948, dans son texte fondateur, par opposition à la maladie, elle a définit la santé comme « un état de complet bienêtre à la fois physique, mental et social ». Face à cette complexité, la science médicale tente d’attribuer un « sens biologique » aux pathologies-diseases afin de mieux les diagnostiquer, les soigner et les résoudre. En revanche, elle n’est pas du tout encline à aider les patients dans la recherche du « sens symbolique » qu’ils ont besoin de rattacher à leurs malaises-illnesses. Du coup, la pratique médicale laisse peu de place à l’écoute des malades, elle oublie à quel point il est important pour eux de pouvoir inscrire leur expérience de la souffrance dans le cours de leur existence singulière, en fonction d’un passé auquel ils sont identifiés et, surtout, dans l’espoir d’un futur qu’ils espèrent pouvoir vivre avec ou sans leur pathologie. C’est regrettable car ce « sens symbolique » génère un espoir absolument favorable pour le processus de guérison. De la même manière, la science médicale est peu préparée à considérer le « sens collectif » des maladies-sicknesses. Pourtant, dans de nombreuses cultures traditionnelles, ce « sens collectif » tient une place primordiale dans les rituels thérapeutiques ; à l’occasion de la maladie d’un seul, c’est toute la communauté qui doit s’interroger, chacun de ses membres est invité à revoir ses rapports interpersonnels avec les autres et le groupe dans son ensemble est amené à examiner les relations qu’il entretient avec l’environnement dans lequel il évolue. Cette attitude débouche inévitablement sur des mesures préventives qui manquent cruellement dans notre rapport moderne à la maladie. A fortiori lorsque cette maladie prend le nom de « cancer » !
Pour terminer cette réflexion à propos du cancer, j’aimerais citer Viktor Frankl, psychiatre viennois qui au retour des camps de concentration de la seconde Guerre mondiale a écrit le très bel ouvrage Découvrir un sens à sa vie. « L’important n’était pas ce que nous attendions de la vie, mais ce que la nous apportions à la vie, écrit-il. Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait s’imaginer que c’était à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. » Pourvu qu’au-delà de nos croyances, au-delà de nos représentations imparfaites de la réalité, nous ayons la sagesse d’élargir notre champ de vision, de changer notre regard sur le monde et sur nous-mêmes afin que, confrontés à l’augmentation du nombre des cancers, nous comprenions qu’il y a là une opportunité unique de grandir et d’évoluer.